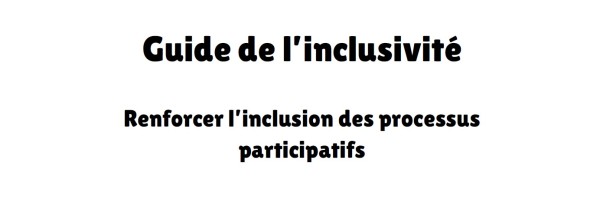Mobiliser et faire dialoguer une diversité de publics
Mobiliser et faire dialoguer une diversité des publics
Mobiliser et faire dialoguer une diversité de publics
La mobilisation d’une diversité de publics est un enjeu essentiel qui conditionne la qualité des démarches participatives. Ce dossier vous propose de prendre en main les outils du leadership inclusif - posture permettant de mobiliser la richesse des différences pour activer l’intelligence collective - et ceux de la DEI (diversité, équité et inclusion) - héritière des luttes pour l’égalité désormais intégrée aux meilleures pratiques de transformation sociale et institutionnelle. Articulés ensemble et appliqués au champ de la participation citoyenne, ces outils permettent de concevoir des espaces participatifs plus innovants, inclusifs et légitimes au service de projets répondant à la diversité des besoins.
Le leadership inclusif est avant tout une pratique relationnelle permettant de créer les conditions d’une participation équitable, d’un sentiment d’appartenance partagé, d’une expression authentique et d’une co-responsabilité durable. Il repose sur l’écoute active, la réflexivité, la reconnaissance des identités plurielles et la co-construction d’objectifs communs. Il exige à la fois un travail personnel (prise de conscience des biais, humilité, curiosité) et des compétences interpersonnelles fines pour canaliser — plutôt que neutraliser — la diversité des points de vue au service de l’intelligence et de la performance collectives.
L'approche de la DEI recouvre trois notions clés. La diversité désigne la pluralité des profils au sein des équipes et des publics (genre, origine, âge, handicap, orientation sexuelle, statut socio-économique, etc.). L’équité consiste à ajuster les moyens pour corriger les inégalités structurelles. L’inclusion, enfin, vise à créer un cadre où chaque personne se sent légitime, reconnue et valorisée pour ce qu’elle est, dans toutes ses singularités.
Les recherches empiriques en sciences sociales et en neurosciences confirment l’impact positif de ces approches y compris dans la sphère publique. Elles favorisent une meilleure qualité des décisions collectives, une pluralité accrue des points de vue et une attention renforcée aux besoins réels des populations. Elles permettent une inclusion plus effective des personnes structurellement marginalisées, tout en renforçant la cohésion sociale, la légitimité démocratique et la résilience des institutions publiques.
Vous connaissez d'autres ressources de qualité sur cette thématique ? N'hésitez-pas à contribuer en créant des ressources sur le site ou en nous contactant à contact [at] 3ddge.ch